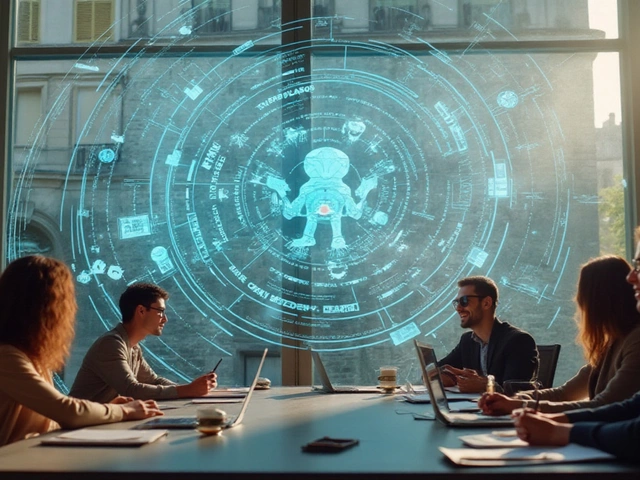Entre ses mains (2005) : le thriller psychologique d’Anne Fontaine décrypté
Un thriller intime au cœur de Lille
Un baiser et un scalpel dans la même histoire : c’est le pari risqué d’Anne Fontaine avec Entre ses mains (2005). Le film installe son trouble loin des clichés, au milieu des vitrines de Noël et du froid lillois. Ancrée dans un quotidien banal, une obsession s’allume, sans bruit, et tout bascule. Claire Gauthier (Isabelle Carré), experte d’assurance, mène une vie réglée avec son mari Fabrice et leur fille Pauline. Une simple déclaration de dégât des eaux l’amène à croiser Laurent Kessler (Benoît Poelvoorde), vétérinaire au charme opaque. Ce contact professionnel, presque anodin, devient une ligne de fracture.
Le décor compte autant que l’intrigue. Lille, l’hiver, les lumières, les rues mouillées : le cadre déjoue l’attendu. Le film ne cherche pas l’exotisme, il fouille l’ordinaire. Pendant ce temps, une série de meurtres de femmes au scalpel glace la ville. Cette menace hors champ, relayée par les journaux et les conversations, pèse sur chaque regard, chaque silence. Fontaine choisit la suggestion plutôt que la démonstration. Le danger n’explose jamais à l’écran, il s’infiltre.
Tout passe par les textures : la lumière blême des bureaux, les couloirs presque vides, les appartements tièdes, un café trop calme. La caméra s’approche à pas lents, colle au visage de Claire, respire avec ses hésitations. Plus elle s’expose à Laurent, plus l’image semble vaciller. Un manteau mal accroché, une main insistante, une phrase coupée, un objet trouvé dans une poche — un scalpel — suffisent à installer une suspicion persistante. Est-ce une coïncidence? Un signe accablant? Fontaine laisse la réponse flotter, et le spectateur, comme Claire, navigue à vue.
Le cœur du film n’est pas la chasse au tueur. C’est l’énigme du désir. Pourquoi s’approcher de ce qui fait peur? Pourquoi chercher la chaleur là où brûle le danger? La mise en scène refuse la voie facile du sensationnel et du sadomasochisme illustratif. On reste au niveau des frémissements : un plan qui s’attarde, un souffle trop proche, un pas en arrière trop tardif. Le thriller se double d’un récit romantique — pas au sens fleuri, au sens du vertige. La frontière entre attirance et menace devient poreuse.
Claire est écrite à l’envers des archétypes. Pas de victime naïve, pas d’héroïne bravache. Elle est compétente, aimée, mais fissurée par une curiosité qu’elle ne s’explique pas. Isabelle Carré joue ces micro-fêlures à la perfection : un regard qui s’échappe, une parole retenue, une attention démesurée aux détails de Laurent. Elle ne tombe pas, elle glisse. Et le spectateur ressent cette pente douce, presque irrésistible, où la raison peine à reprendre pied.
Laurent, lui, reste un mystère mobile. Séducteur, oui, mais comment? Par sa lenteur, ses absences, son côté animal qui n’a rien d’affiché. Benoît Poelvoorde, qu’on connaît souvent pour son humour, contourne son image sans l’effacer. Il desamorce la blague, garde la nervure tragique. Sa voix descend d’un ton au bon moment, son sourire s’éteint une seconde trop tard. Le personnage fait naître un doute permanent : homme blessé qui cherche une échappée? Prédateur qui rôde? Les deux à la fois? L’ambiguïté, ici, n’est pas un truc de scénario, c’est une matière vivante.
La série de meurtres reste en bordure, mais elle charpente la tension. Chaque nouvelle annonce ravive la peur, et chaque rapprochement entre Claire et Laurent devient plus dangereux. Fontaine joue avec la géographie des lieux — cages d’escalier, parkings vides, couloirs d’immeubles — pour faire résonner cette inquiétude. On n’assiste jamais au crime, on en sent la menace. C’est presque plus violent.
Jeu d’acteurs, mise en scène et héritage
Le film tient sur un duo. Isabelle Carré compose une femme ordinaire qui prend des décisions extraordinaires, sans jamais forcer le trait. Pas de grands gestes, pas de tirades. Juste des choix à faible bruit qui engagent toute une vie. Face à elle, Poelvoorde installe une présence qui magnétise les regards et fragilise les certitudes. Ensemble, ils forment une ligne de haute tension. L’érotisme est discret, sans chorégraphie, presque accidentel. Et c’est pour ça qu’il fonctionne.
Anne Fontaine met en scène la confiance et la défaillance. Fidèle à son goût pour les zones grises — l’intime, le secret, les arrangements avec soi-même — elle privilégie l’ellipse et les silences. La caméra n’explique pas, elle suggère. Le découpage est net, l’édition sèche, la musique, quand elle survient, ne sert pas de béquille émotionnelle. Elle laisse au spectateur la responsabilité du sens. Ce choix de retenue donne au film son étrangeté : on croit pouvoir trancher, puis une image contredit notre certitude.
Le motif hivernal ne fait pas joli. Il serre l’étau. Les guirlandes, les marchés, les fêtes de fin d’année installent une dissonance : l’euphorie collective autour de Noël contraste avec l’isolement de Claire. Plus la ville scintille, plus l’histoire s’assombrit. Les lieux publics — patinoires, magasins, restaurants — deviennent des théâtres de micro-violences invisibles : regards appuyés, mains qui frôlent, paroles ambiguës. Fontaine capte ces accidents minuscules qui font basculer une relation.
Sur le plan visuel, la palette est froide, parfois métallique. Les intérieurs aux couleurs cassées renvoient les personnages à leurs zones d’ombre. Les vêtements suivent la même logique : rien d’ostentatoire, mais des textures qui racontent. Un manteau sombre, un col relevé, une écharpe qui cache la gorge — autant de petites armures qu’on enlève au mauvais moment. Le montage ménage des trous d’air qui laissent affleurer l’angoisse. Ces blancs, ces respirations, permettent à la peur d’entrer sans frapper.
Le récit tient aussi parce qu’il ne cherche pas à « gagner » contre le spectateur. Il n’écrase pas les possibles sous une explication finale. L’issue, discutée à la sortie en 2005, a divisé : certains y ont vu une pirouette, d’autres une fidélité à la logique interne du film — le réel, souvent, refuse de se boucler. Cette fin ouverte n’est pas une coquetterie. Elle prolonge l’expérience : on sort du film avec une inquiétude intacte, et une question simple, dérangeante, qui n’a pas de bonne réponse.
Revu aujourd’hui, le film résonne autrement. Le regard posé sur la peur des femmes dans l’espace public, sur les dérives d’un charme insistant, sur la difficulté à nommer ce qui se passe quand le désir se mêle au soupçon, a changé. Sans devenir un manifeste, Entre ses mains dialogue avec nos débats contemporains sur le consentement et l’emprise. Le film ne donne pas de leçon. Il montre l’instant où l’on se tait alors qu’il faudrait parler, et l’instant où l’on parle sans être sûr de soi.
Dans le paysage des thrillers français des années 2000, l’œuvre d’Anne Fontaine occupe une place à part. Pas de surenchère, pas de gadget scénaristique. Une mécanique fine, presque minimaliste, qui met la pression de l’intérieur. La violence n’est pas dans les actes spectaculaires, elle est dans la contradiction à tenir : vouloir et craindre en même temps. C’est précisément ce fil tendu que le film tire jusqu’au point de rupture.
On pourrait chercher des modèles américains, des références appuyées, mais Entre ses mains s’affirme surtout par sa singularité. C’est un thriller sentimental où le romantisme n’adoucit rien. Le danger ne se résout pas dans l’étreinte. Au contraire, il s’y cache. Quelques scènes, sobres, restent en mémoire : une promenade trop longue, un bureau trop silencieux, un salon trop chaud, un baiser qui laisse un frisson d’alarme. Leur force vient de ce que le film refuse d’apposer des étiquettes rassurantes.
Si le film a marqué, c’est aussi parce qu’il fait confiance à l’intelligence du public. Il parie sur la nuance, la contradiction, le doute fertile. Il demande de rester attentif aux gestes modestes, aux micro-variations de ton, aux indices qui ne s’assemblent jamais complètement. Cette exigence ne fait pas obstacle au plaisir de cinéma, au contraire : elle nous remet au centre de l’expérience. On n’absorbe pas une vérité prête-à-porter, on cherche, on hésite, on se contredit, comme Claire.
Au final, Entre ses mains s’impose comme un thriller psychologique rare : un film qui sait rester proche des corps et loin des effets, qui croit aux silences, à la durée, à l’opacité du désir. On y revient pour son ambiance lilloise glacée, pour la partition millimétrée d’Isabelle Carré, pour l’opacité magnétique de Benoît Poelvoorde, et pour la façon, si particulière, dont Anne Fontaine met en scène la tension d’aimer ce qu’on redoute.